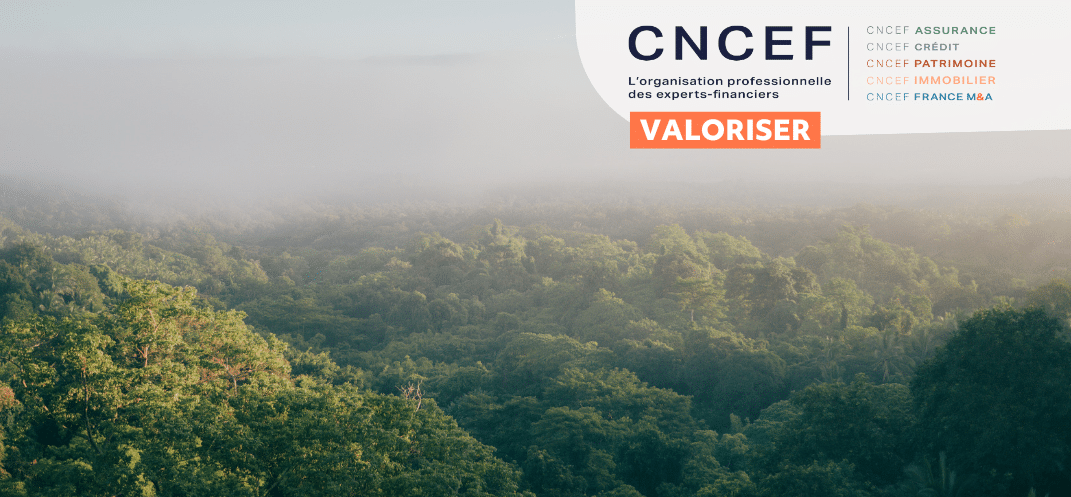Préambule de Pierre-Jean Gaudel, président de l’Académie de l’économie durable
La vocation de l’Académie est d’offrir, au sein de la CNCEF, un espace d’échanges et d’initiatives s’inscrivant dans le temps long, pour réfléchir aux évolutions profondes des métiers de ses 14 000 adhérents et à leur contribution au service de l’intérêt général et national.
Face à la transformation profonde de notre environnement économique, nous avons interrogé les présidents des cinq associations membres de la CNCEF : Stéphane Fantuz (CNCEF Assurance), ), Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine), Côme Robet (CNCEF Crédit), Marc Sabaté (CNCEF France M&A), Jean-Paul Serrato (CNCEF Immobilier).
À travers leurs regards croisés, ces dirigeants partagent leur lecture des enjeux contemporains liés à l’économie durable, à la souveraineté économique et à la mondialisation, ainsi que les pistes concrètes envisagées pour accompagner leurs membres dans ce contexte.
Économie durable : une conscience encore émergente, mais en mouvement
Les enjeux liés à l’économie durable progressent dans les esprits, mais leur prise en compte concrète varie fortement d’un secteur à l’autre. Les professionnels de la CNCEF y sont inégalement préparés, selon la taille de leur structure, leur exposition à la réglementation, et leur proximité avec les circuits d’investissement ou les décisions publiques.
Dans le secteur de l’assurance, Stéphane Fantuz constate une montée en puissance de la complexité réglementaire, qui transforme le métier : « Un courtier qui assure un parc photovoltaïque devient un acteur stratégique. Nous devons sortir de la logique du produit standard pour intégrer le risque environnemental dans toute sa complexité. »
Pour lui, l’économie durable impose d’intégrer davantage d’anticipation et d’analyse dans l’offre de services.
Pascale Gloser, pour les conseillers en gestion de patrimoine, évoque une prise de conscience réelle, mais bridée par les limites de l’offre disponible. Depuis le 1er janvier 2024, les CGP doivent recueillir les préférences de leurs clients en matière de durabilité. « Les produits adaptés sont encore rares, les labels peu lisibles, et les attentes des clients souvent très élevées. » Elle plaide pour un effort collectif de clarification et de pédagogie, à la fois vis-à-vis des clients et des professionnels.
Dans le domaine immobilier, Jean-Paul Serrato pointe les injonctions contradictoires qui fragilisent les acteurs de terrain. Entre exigences énergétiques, contraintes foncières et instabilité politique, l’économie durable est parfois vécue comme un obstacle. « Toute décision politique, toute tension géopolitique a un impact direct sur notre métier. »
Il appelle à une vision d’ensemble, partagée entre pouvoirs publics, territoires et investisseurs.
Pour les professionnels du M&A, Marc Sabaté constate que l’économie durable est encore souvent perçue comme un élément imposé par les investisseurs. Les petites structures, qui composent l’essentiel de la profession (90 % ont moins de cinq collaborateurs), n’ont pas toujours les moyens de s’en saisir comme levier stratégique. « Les enjeux ESG apparaissent souvent comme une contrainte imposée par les donneurs d’ordres. Il nous faut les outiller pour qu’ils les transforment en levier de valorisation. »
Enfin, dans le crédit, Côme Robet souligne que la pression sur les marges a fragilisé les modèles économiques, rendant difficile l’anticipation. « Certains ont perdu jusqu’à 50 % de leur chiffre d’affaires avec la baisse des commissions bancaires. »
Il propose de repositionner la valeur des courtiers autour du conseil, et de saisir l’économie verte non comme une contrainte, mais comme une opportunité à construire.
Souveraineté et relocalisation : un levier d’ancrage local
Dans un contexte de dépendance accrue aux marchés internationaux et de crise des circuits d’approvisionnement, les professionnels de la CNCEF s’interrogent sur les moyens de renforcer la souveraineté économique nationale. Tous soulignent l’importance d’un ancrage territorial fort, qui passe aussi bien par l’investissement, la fiscalité que la maîtrise de la donnée ou la consolidation d’acteurs locaux.
Pour Pascale Gloser, la souveraineté peut s’exprimer dans l’orientation de l’épargne. Les conseillers en gestion de patrimoine sont en première ligne pour flécher les investissements vers des fonds thématiques utiles à la collectivité. « En orientant l’épargne vers des fonds de relocalisation ou de transition agricole, les CGP deviennent des vecteurs de souveraineté. » Elle appelle également à une meilleure visibilité sur les produits labellisés, notamment ceux soutenus par la Banque publique d’investissement (BPI).
Jean-Paul Serrato, du secteur immobilier, souligne les effets dévastateurs de la perte de pilotage sur la politique du logement : « Le logement locatif représentait 40 à 50% du logement collectif neuf et va passer à moins de 10 %. C’est un effondrement silencieux. » Il rappelle que l’immobilier est un pilier de souveraineté, car non délocalisable, mais qu’il est aujourd’hui menacé par la volatilité fiscale et l’absence de vision à long terme.
Dans le crédit, Côme Robet insiste sur la souveraineté numérique. Il alerte sur la captation croissante des données clients par les plateformes bancaires : « La souveraineté numérique est devenue aussi importante que la souveraineté financière. » Il défend le développement d’outils propriétaires hébergés en France pour préserver l’indépendance des courtiers.
Marc Sabaté, représentant les professionnels du M&A, met en avant le rôle stratégique des opérations de consolidation dans la préservation du tissu économique national : « En consolidant des entreprises locales à travers des build-ups, nous contribuons à préserver les savoir-faire et les chaînes de valeur françaises. » Il voit dans le conseil en transmission un levier concret pour ancrer les entreprises dans leur territoire.
Enfin, Stéphane Fantuz s’alarme de l’impact de certains produits d’assurance proposés via la libre prestation de services (LPS), souvent mal adaptés aux réalités françaises. « Il faut réaffirmer la nécessité d’acteurs assurantiels nationaux face à des produits importés. La résilience passe aussi par une filière domestique solide. »
Financer la transition : entre volontarisme et complexité croissante
La transition écologique représente un impératif partagé, mais sa mise en œuvre concrète soulève de nombreuses difficultés, notamment en matière de financement. Les dispositifs existent, mais leur lisibilité, leur accessibilité et leur efficacité restent inégales selon les secteurs et la taille des structures concernées.
Dans l’immobilier, Jean-Paul Serrato insiste sur le caractère long et capitalistique des projets. Les dispositifs publics sont souvent inadaptés à la temporalité réelle des opérations de promotion ou de rénovation. « Il faut six ans pour produire un logement. Si on ne comprend pas cette temporalité, on ne finance pas correctement. » Il plaide pour des mécanismes d’accompagnement plus cohérents avec les cycles longs de l’immobilier, en particulier dans les territoires non métropolitains.
Du côté de l’assurance, Stéphane Fantuz alerte sur les risques juridiques liés aux projets verts mal encadrés. Il cite une affaire dans laquelle des promoteurs éoliens ont été condamnés pour atteinte à la biodiversité. Maître Laurent Gimalac, spécialiste du sujet, souligne ce paradoxe : vouloir promouvoir des énergies renouvelables sans respecter le droit de l’environnement peut conduire à des annulations de projets et à la mise en jeu de la responsabilité pénale de l’entrepreneur. Il appelle les professionnels à intégrer l’évaluation juridique dès la conception des projets durables.
Côme Robet, pour les courtiers en crédit, voit dans les prêts à impact un levier prometteur, mais encore peu exploité. Ces dispositifs, assortis de bonifications de taux selon des critères ESG, peinent à se multiplier en pratique. « Ils existent, mais nos adhérents ne sont pas formés pour les identifier ni pour les proposer. » Il appelle à des outils pédagogiques concrets et des accords mieux diffusés avec les banques.
Pascale Gloser souligne le besoin de données fiables pour évaluer l’impact réel des placements. Elle salue les efforts d’acteurs comme Axylia (fondée par Vincent Auriac), qui développent des méthodologies d’évaluation extra-financière. « Il faut démocratiser ces outils pour qu’ils deviennent une boussole du conseil. » Elle rappelle que les CGP ont une responsabilité croissante dans l’orientation vers des supports ayant un impact environnemental ou social mesurable.
Enfin, Marc Sabaté déplore que les dispositifs de financement durable soient souvent calibrés pour les grandes entreprises. « Les financements fléchés sont trop complexes pour les petites structures. Il faut inventer une ingénierie adaptée à leur réalité. » Il propose que la CNCEF joue un rôle d’interface pour porter la voix des TPE-PME auprès des financeurs publics et privés.
Faire face aux incertitudes : vers une culture commune du risque
Les crises géopolitiques, la volatilité des marchés et l’instabilité réglementaire imposent une réinvention des stratégies de résilience. Tous les intervenants soulignent la nécessité d’accompagner les professionnels dans la gestion des risques, en renforçant les outils, les réseaux et la capacité d’anticipation collective.
Dans le secteur du crédit, Côme Robet constate l’extrême sensibilité du modèle économique des courtiers aux décisions bancaires et aux aléas conjoncturels. « Certains cabinets ont vu leur chiffre d’affaires fondre en quelques mois. La résilience passe par la diversification. » Il milite pour une meilleure mutualisation des ressources, et une montée en compétence sur la gestion du risque économique.
En immobilier, Jean-Paul Serrato dénonce une crise des autorisations administratives : les maires, confrontés à la baisse des dotations et aux tensions locales, freinent les permis de construire. « Les maires refusent les permis faute de moyens pour construire des écoles. Cela bloque toute la chaîne. » Il alerte sur la disparition progressive des petits promoteurs, étouffés par l’incertitude et l’absence de lisibilité.
Pascale Gloser, côté patrimoine, appelle à structurer une veille réglementaire partagée au sein des réseaux professionnels. Les CGP, souvent isolés, ont du mal à anticiper les changements de doctrine. « Nous devons renforcer notre rôle d’interface entre les régulateurs et le terrain. L’anticipation devient stratégique. » Elle voit dans les associations un levier fondamental pour stabiliser l’environnement des indépendants.
Marc Sabaté, quant à lui, évoque les cycles du M&A, extrêmement sensibles aux mouvements macroéconomiques et à la politique monétaire. « Il faut une culture du scénario dans le M&A. Nos métiers sont exposés à des cycles volatils. » Il encourage les professionnels à intégrer la gestion de crise dans leurs plans de croissance et à formaliser leurs analyses de risques.
Enfin, Stéphane Fantuz considère que la donnée est un élément clé de la gestion du risque. Il encourage les assureurs à passer d’une logique d’historique à une logique prédictive. « L’assurance devient un métier prédictif. Nous devons apprendre à traiter la donnée comme un outil de décision collective. » Il prône le développement de référentiels communs et la constitution de bases d’expérience partagées entre acteurs.
Construire un avenir désirable : des métiers en mutation
Au-delà des enjeux immédiats, les présidents de la CNCEF appellent à une transformation en profondeur des métiers du conseil, pour mieux répondre aux attentes sociétales, renforcer l’attractivité des professions et accompagner durablement les transitions économiques.
Jean-Paul Serrato, dans l’immobilier, plaide pour un cadre juridique et fiscal stabilisé. L’instabilité des règles freine l’investissement et sape la confiance. « Tous les deux ans, on change les règles du jeu. Il faut une visibilité à dix ans pour réconcilier le logement et les investisseurs. » Il insiste également sur l’importance de la mutualisation, notamment via des plateformes ou des réseaux professionnels, qui permettent aux indépendants de gagner en sécurité et en expertise.
Côme Robet appelle à une transformation collective des outils, des compétences et des pratiques. La transition ne pourra pas se faire sans alliances concrètes entre professionnels. « Pourquoi ne pas mutualiser les outils de diagnostic, les plateformes de conformité, ou encore les modules de formation ? » Il défend une logique d’écosystème, où chaque cabinet trouve des ressources partagées pour monter en qualité.
Stéphane Fantuz brosse le portrait du courtier de demain : un professionnel transversal, enraciné dans les territoires, capable de dialoguer avec les entreprises, les collectivités et les citoyens. « Il sera prospectiviste, conseiller stratégique, partenaire de transition. Ce sont ces profils que nous devons encourager. » Il plaide pour une revalorisation des métiers du conseil à travers la formation continue, la certification et la reconnaissance d’un rôle stratégique.
Marc Sabaté encourage à décloisonner les professions. Les clients évoluent dans un monde complexe, et attendent des réponses globales. « Nos adhérents travaillent avec les mêmes clients. Il est temps de créer des passerelles entre le M&A, le patrimoine, l’assurance et le crédit. » Il appelle à penser le conseil comme un métier transversal, tourné vers la création de valeur durable.
Enfin, Pascale Gloser souligne la nécessité d’attirer une nouvelle génération, sensible aux enjeux environnementaux et sociaux. « 60 % des cabinets en patrimoine sont unipersonnels, mais la jeune génération est là. » Elle insiste sur le rôle de la CNCEF dans la transmission d’un socle éthique, d’une culture professionnelle commune et d’une vision inspirante.
Conclusion par Pierre-Jean Gaudel
Nos échanges révèlent combien les enjeux d’économie durable, de souveraineté et de mutation des modèles concernent toutes les composantes de la CNCEF. Qu’ils soient courtiers, CGP, experts M&A, professionnels de l’immobilier ou de l’assurance, tous doivent aujourd’hui conjuguer expertise métier et vision à long terme.
L’Académie de l’économie durable de la CNCEF entend jouer pleinement son rôle de catalyseur, de passeur d’idées, de créateur de ponts entre les métiers. En valorisant les initiatives et les réflexions des Présidents d’associations de la CNCEF, elle contribue à donner corps à une ambition commune : faire des professionnels de la CNCEF des acteurs-clés d’une économie plus durable.
—
Cet article a été rédigé en collaboration étroite avec Julie Lauré.
Pour toute question, notre équipe reste à votre écoute : concours-academie@cncef.org
Retrouvez davantage d’informations sur l’Académie en cliquant ici.
Pour plus d’informations, suivez-nous sur nos pages Facebook et Linkedin